Roland BUSSELEN

Roland Busselen est né orphelin, en 1931, à Uccle, qui est devenue l’une des dix-neuf communes de Bruxelles. C’est en autodidacte qu’il doit s’assumer, et quel parcours ! Cet infatigable combattant sera ainsi légionnaire, puis, publicitaire et enfin surtout, poète et directeur de revue. L’art, la peinture, notamment, occupant une place prépondérante dans sa vie ; il sera l’ami des peintres, ces frères voyants. Parmi eux, les surréalistes Max Ernst, René Magritte et Paul Delvaux, qui l’ont illustré. Roland Busselen fonde enfin, en 1959, avec Alain Bosquet, la revue L'VII (35 numéros) qui, jusqu’en 1970, publie, entre autres, sous une couverture dessinée par Max Ernst : Roger Caillois, Tristan Tzara, Joyce Mansour, Miguel Angel Asturias, Georges Seféris, Octavio Paz, Lawrence Durrell, Eugène Ionesco, Marguerite Yourcenar, Samuel Beckett, Emil Cioran, Stéphane Lupasco ou Jean Rousselot. Busselen publie ensuite la revue B + B, qui compte cinq numéros de 1970 à 1972.
C’est peut-être en raison de ses origines (je cherche mon sang d’enfant – au creux des artères de ma mère), de son parcours (Je reviens d’un très long voyage – au-delà de la tempe éclatée), que la poésie de Roland Busselen est dominée, comme l’a relevé Serge Brindeau, par le sentiment de la solitude, la peur du vide, l’angoisse liée à l’écoulement du temps, à la menace de la mort. Je vis, quel piège, écrit Busselen dès son premier livre, Moi l’exil (1959). Le Moi est constamment tourmenté, occupe le centre de ce « désert », semés de mots, auxquels le poète s’attache, dans une proximité avec le surréalisme, en nous rendant plus insupportable encore la pensée de la mort, par l’étrange vérité de ses images : les portes de ma chambre – font grincer le silence en crabe. Ou encore : j’ai sucé le lait des pierres – et les aiguilles ensemble font naufrage – dans ma pensée. Cela fera dire (in Magazine littéraire n°55/56, 1971) à Jean Breton, ami et éditeur du poète : On a rarement vu un poète s’autopsier avec une telle brutalité ! Poésie qui ne sourit jamais, poésie de l’introspection, de l’agression contre soi et le monde, et où la tutelle du désespoir est goûtée avec un trouble plaisir.
Busselen à coups de poèmes crispés, s’interroge sur l’origine (Qui a contenu les entrailles où je vis ?), sur le « pourquoi » de l’existence (il méprise d’avance les réponses), sur les signes (un vide pour remplir un autre vide), sur les mots (clapotis d’eaux-mortes), avec une conscience « aux limites du vertige ». Il ne se fait d’illusions ni sur autrui, qui parle « comme s’il voulait vous mordre », ni sur sa propre richesse intérieure (Tu cherches ce rien – culminant – toi…). Mais il faut se poursuivre, arracher les apparences, se laver par l’infra-rouge de la franchise, se battre. Même si la vie est « évidence de l’absent » et si l’on y est « seul toujours pourri de durée », voire « camé irrécupérable ».
Un pessimisme un peu encombrant, à la Cioran ? dira-t-on ? Et quelles en sont les justifications ? Selon Busselen, se taire équivaudrait à « protéger la mollesse jaillie du silence » et à mettre « la parole en cause ». À l’en croire, le poème justifierait une vie fût-elle absurde. Il le dit : il s’agit de « protéger » le poème, d’« être fou de lui ». Roland Busselen creuse toujours. Sans pitié et sans autre confidence que l’indispensable, il dénonce « le petit monstre qui me fait respirer : ma peur ». Il égrène ses litanies de la rage, il joue d e out avec « le raffinement du doute », le jeu de mots sardonique (l’angle de l’ongle). Surtout il y a en lui un magnifique poète baroque (le rasoir sur la plage qui a fait un miracle). Ses métamorphoses, son anthropomorphisme très délirant, son humour, l’amour suspecté (J’ai déplacé les chairs inutiles), sa passion pour les mots (selon la manière dont on les vit) créent, en vers courts, braqués sur nous comme des gueules de révolver – un univers fabuleux et grinçant.
Le domaine de Roland Busselen est bourré de bêtes, d’objets hirsutes, de fleurs cosmiques, de « simulacres » hagards ou ivres. Une telle fois dans le verbe, même s’il la bouscule, crée une perpétuelle magie. N’enferme-t-il pas le vent, par exemple, dans « les radiateurs des immeubles abandonnés » ? Quel déchet quel festin, résume Busselen parlant de la farce de vivre. Mais, pas de méprise : Roland Busselen n’a pas, n’a jamais, tué en lui la sensibilité. Yves Berger en témoigne, lorsqu’il préface Passages (1985), l’anthologie poétique 1959-1984, de Busselen : « Roland Busselen n’est pas d’un bois friable. Il ne se laisse pas avoir et prendre. Le fallacieux, le douceâtre, l’oripeau, le clinquant, le déguisé n’ont pas de prise sur lui. » Yves Berger salue une œuvre qui « à la force impressionnante de l’unité » : « La poésie de Roland Busselen, c’est, s’ils se peuvent accoupler, tout le noir du ciel et de la terre. » Quel peut bien être le sens de l’exercice poétique ? La raison du combat que le poète livre dans le langage, avec lui et contre lui ? Que le poète peut-il attendre de la poésie ? Rien que la confirmation de ce que donnent à voir et à subir le monde et les hommes. La poésie n’est pas une entreprise de diversion et le poète ne peut échapper au poids du tragique qui la fonde elle aussi totalement. La poésie ne rachète rien ni personne. Ne permet aucun échappatoire. Le poète plonge en elle.
Dans son œuvre poétique, Roland Busselen traduit, sans que cela devienne une dépouille, la difficulté d’être, à travers le langage qui devrait rapprocher les hommes. Toute figure, toute trace ne sont que des indices de la perception. Appauvrie par le dit, l’écrit. Plèvre admirable sans doute, qui en cristallise l’inaccessible. Dans les poèmes de Busselen, la parole cède à la pureté son ton d’oracle pour mieux se blesser à au contact de la réalité.
Busselen écrit : « On use les images par des explications. De plus en plus l'incohérence dont le langage est capable m'étonne. Les mots ne sont pas des explications mais des solutions. Trop souvent le contact avec la vie est réduit à des phrases. Et par là devient pour beaucoup intérieur. J'ai imaginé qu’aveugle, l’homme redécouvrait le « contact » des choses, la réalité, non définie par avance, de ses sentiments. En alternance bien sûr avec son éducation, mots, attitudes. Ce que commence l’image est perçu par l’oeil. La définition en fait est abstraite. Faite de souvenirs partiels. L’aveugle invente sa définition. »
La dérision, l’humour noir, l’angoisse, la rage sur fond d’enfance bafouée, la force âpre des formulations d’introspection sauvage de Busselen, créent, en vers braqués sur nous comme des armes, un univers baroque, grinçant, peuplé aussi de bêtes, d’objets hirsutes, de fleurs et de fables cosmiques. Roland Busselen : une voix majeure de la poésie belge, de la poésie contemporaine.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Epaules).
Illustration: Autoportrait (encre sur papier, 1970) de Roland Busselen.
À lire : S’il vous plaît (Éd. Dutilleul, 1956), Quand les dieux visitent nos tombeaux (Éd. Dutilleul, 1958), Moi l’exil (Seghers, 1959), Grand-peine (Seghers, 1960), Supplément d’âme (Seghers, 1962), Démuni que je sois (Seghers, 1963), Cadènes (Seghers, 1966), Un quelqu’un (Seghers, 1968), Malaïgues (Seghers, 1970), La Main de Samothrace (Grasset, 1971), Quelques « je » quelques « tu », quelques « il » (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1974), Au royaume des aveugles (Grasset, 1975), Les Errants (éd. Saint-Germain-des-Prés, 197), Là où va l’Île elle va (Belfond, 1979), Anamnèse (éd. de L'VII, 1980), Choucas d’usure (éd. Marc Pressin, 1981), Relief du Hasard (Belfond, 1983), Brisures, Usures et Bruits (Grasset, 1984), Passages, anthologie poèmes 1959-1984, (Belfond, 1986), Encre, le nom de mon esprit (éd. Saint-Germain-des-Prés, 1989), De Défi Définitif (éd. Vander, 1989), Chas (éd. Vander, 1994), N’est-ce pas ? (éd. Vander, 1998), Geste de mémoire (éd. Vander, 2003), Egodyssée (L’Âge d’Homme, 2006), Non-dits ou l’oubli de la mémoire (L’Âge d’Homme, 2012).
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
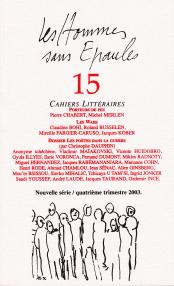
|
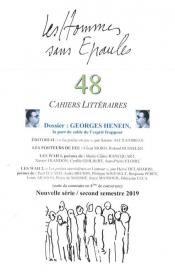
|
|
| Dossier : LES POETES DANS LA GUERRE n° 15 | DOSSIER : Georges HENEIN, La part de sable de l'esprit frappeur n° 48 |
